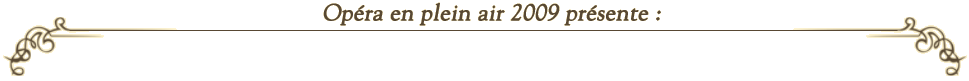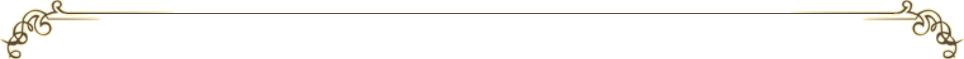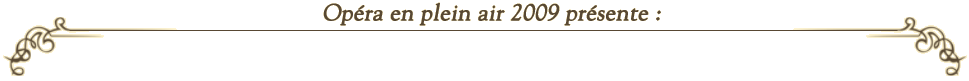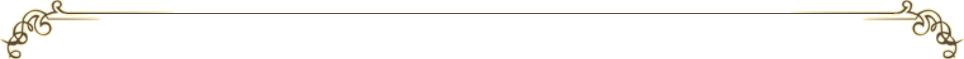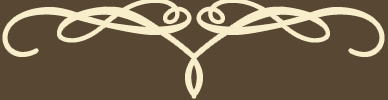C’est sous le titre Le Roi s’amuse, que la pièce de Victor Hugo avait été présentée au public parisien, en 1832, provoquant le scandale et récoltant l’échec: le gouvernement de Louis-Philippe, choqué par une «immoralité inacceptable», refusait qu’un roi de France (François Ier) fût présenté comme un horrible libertin, surtout sous la plume d’un auteur affiché républicain...
Faut-il voir dans ces circonstances controversées l’élément qui suscita chez Verdi l’envie de reprendre le sujet? Lui et son librettiste Piave avaient, eux aussi, subi la censure, l’Italie était en pleine effervescence politique, le sujet développé dans Le Roi s’amuse réunissait de façon idéale le drame psychologique individuel et la critique des puissants. En déplaçant l’action depuis la cour du roi de France jusqu’à celle du duc de Mantoue, Verdi - qui s’impliquait toujours activement dans l’écriture du livret - et Piave réussirent à calmer les susceptibilités sans affadir le message...
Les noms furent changés et initialisés, Triboulet, le célèbre bouffon de François Ier, se transforma en Triboletto avant de devenir Rigoletto, jeu de mot sur le nom du bouffon et sur le verbe rire. Le génie de Verdi fit le reste.
L’écoute de Rigoletto révèle combien, chez Verdi, c’est le théâtre qui guide la musique. Premier des opéras formant avec La Traviata et Il Trovatore la fameuse «trilogie populaire», il se situe au point d’équilibre idéal entre la tradition italienne du bel canto et les forces novatrices qui conduiront aux chefs-d’oeuvre ultérieurs comme Don Carlos et Otello. «Le beau chant» est encore central, mais débarrassé des ornementations qu’affectionnaient Rossini et
Donizetti. La virtuosité est entièrement soumise à l’expression dramatique et rejoint ainsi la spontanéité du théâtre parlé, paré de toute la richesse de la voix chantée; dans certains cas, c’est même à l’orchestre qu’est confiée la mélodie et c’est la voix qui est en charge de la conduite dramatique.
Originalité certaine, Verdi réduit le rôle des airs solistes - cinq en tout- pour privilégier les duos et les ensembles (il déclara même qu’il avait pensé Rigoletto comme un enchaînement ininterrompu de duos) et rejoindre cette volonté qui hantait les compositeurs du début du XIXème siècle d’unir plus intensément le drame et la musique. Au-delà des duos, son opéra contient des ensembles exceptionnels de verve et de vie et un quatuor entré dans la légende, celui rassemblant Rigoletto, Maddalena, le Duca et Gilda, dans l’acte III. Lorsque Rigoletto fut présenté à Paris, Hugo s’inclina devant cette prodigieuse réussite dramatique que «seul l’opéra peut réussir et qui est interdite au théâtre...». Enfin, dans le traitement de l’orchestre, Verdi opère une libération comparable à celle pratiquée dans le chant: la texture sonore est devenue plus souple, plus malléable et dès lors plus expressive, et c’est par l’introduction de nuances, de couleurs, de transparences - et non par une augmentation des effectifs ou par la puissance sonore - que l’orchestre atteint sa force dramatique et son pouvoir de conviction.